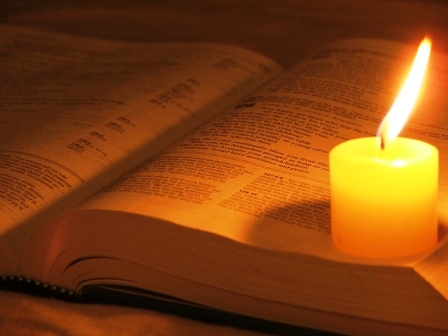

Pour lire la Bible, les Evangiles dans la tradition monastique catholique.
« Cherchez dans la lecture, vous trouverez dans la méditation ; frappez dans la prière, vous trouverez dans la contemplation »
Une lecture dans l’Eglise temple de l’Esprit saint !
Une lecture en Eglise [3] On risque toujours d’interpréter, de donner un sens qui fait dévier la parole de Dieu vers une parole humaine, vers ce que je pense, vers ma parole. Simplement parce que je ne comprends pas, ou bien encore c’est plus gênant, parce que je fais dire à la Parole ce que je veux qu’elle dise... C’est pouquoi lire la parole de Dieu implique de le faire « dans l’Esprit » c’est-à-dire de lire avec l’Eglise. L’épiclèse, l’appel de l’Esprit, est l’œuvre de l’Eglise toute entière, corps du Christ, peuple de Dieu, c’est ce qu’elle fait dans la célébration eucharistique en la personne du prêtre. C’est de cet appel dont le prêtre, à cause de son ministère, fait écho qu’est donnée la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie... la présence du Christ est présence qui nous vient par l’Eglise. Il en est de même pour la Parole.
L’église, dans la célébration de la Parole, se met en situation d’écoute de la parole de Dieu. Cette prière de l’épiclèse [4] que nous devons faire avant d’aborder notre lecture amoureuse dépend directement de cette attitude de réception. Dans ma « lectio divina » mon quart d’heure, mon heure quotidienne, je viens entendre Dieu me parler, de la même façon qu’à l’église, avec les autres, je viens écouter la parole. 4Faire lectio-divina, c’est devenir une pierre vivante de l’Eglise qui écoute la parole de son Seigneur et qui cherche à vivre et manifester le « pas encore » du Royaume dans son « déjà là » ! 4 Le fait de lire et de méditer, « dans la tradition », c’est à dire en la connaissant au moins un peu et en laissant mon jugement être éclairé, éduqué, transformé par elle, est typiquement catholique et orthodoxe, alors que les Eglises protestantes en général proposent une lecture et une interprétation plus personelles, sous l’action directe de l’Esprit saint.
Dans l’Esprit de Dieu. Commencer par une épiclèse n’est pas forcément un garant contre les erreurs et les interprétation personnelles abusives, mais celà tend à nous placer dans une attitude de réception et de docilité à l’Esprit saint. Attention, cela ne veut pas dire que l’originalité soit interdite ! Qu’on pense à saint François, qui comprend avec une telle profondeur l’appel de l’Evangile à la pauvreté qu’il se met nu devant l’évêque et tout le petit peuple d’Assise,... voilà une lecture écclésiale très libre ! Le fait de s’insérer dans la tradition ne tue pas la prophétie, 4L’interprétation en Eglise n’empêche pas la prophétie, mais elle la replace dans le plan de salut guidé par la Providence.4simplement elle l’inscrit dans la continuité de l’œuvre de salut de Dieu sur la terre.
Cette docilité à l’Esprit signifie que la lecture se fait non pas seulement par une action simplement humaine, mais dans une coopération, une « synergie » entre l’Esprit de Dieu et celui de l’Homme. N’oublions pas que l’Esprit de Dieu est « comme une colombe », elle ne s’approche de nous que si nous l’apprivoisons par la docilité, la tenacité, un certain calme...
Cette attitude de dépendance de l’Esprit saint, de coopération avec lui ne peut se faire que si j’accepte de me décentrer de moi-même, de mes besoins, de mes questions même, de mes inquiétudes. Si je suis trop plein de moi-même et du « bruit » de mes pensées, de mes passions et de mes sentiments, je peux difficilement me laisser approcher par l’Esprit saint. Une vraie lecture de la Parole ne cherche pas à répondre à des questions ni à des besoins, ce qui serait une vision très utilitariste, mais elle vise simplement à me faire entrer dans une présence, un vis-à-vis avec le Seigneur. Il est bien évident que cela répondra après coup à des besoins et des questions très profondes en moi, mais comme par surabondance, pas de façon directe.
[1] terme latin qui désigne une lecture spirituelle de l’écriture.
[2] C’est à dire naissance avec.
[3] Temple de l’Esprit est une des images données par le concile Vatican II pour parler de l’Eglise. LG6
[4] Epiclèse veut dire appel de l’Esprit, c’est le moment où le prêtre dans la prière eucharistique appelle l’Esprit saint sur les dons pour qu’il deviennent le corps et le sang du Seigneur.
Cherchez dans la lecture
Nous l’avons dit il faut prier, entrer dans une attitude de docilité par rapport à la traditon et à l’Esprit saint, mais n’oublions pas de lire !
![]() Un temps particulier. Nous sommes des êtres incarnés et nous appartenons à l’espace et au temps, tout ce que nous faisons s’inscrit dans le temps. Pour vraiment lire la parole fructueusement il est donc nécessaire de lui réserver un temps particulier dans notre journée. Un temps particulier propice, autant que possible, au silence et au calme. Souvent le matin tôt avant une 4Prendre un temps de lectio chaque jour, c’est semer dans notre cœur la semance de Dieu dans notre vie...4 journée de travail ou le soir. Il est important de se souvenir que « ce qu’’on ne fait pas chaque jour, on ne le fait pas durant toute sa vie ». Ce qui importe c’est la fidélité et pas forcément la quantité. Le risque, c’est de ne pas définir ce temps, c’est que notre lecture prenne simplement la place vide dans notre emploi du temps, une place qui témoignerait de notre peu d’amour pour la parole du Seigneur ! Par une lecture régulière et fidèle nous plantons alors dans notre vie cette semence de la Parole, comme un semeur qui répète son geste à chaque pas pour ensemencer tout un champ. Or notre champ, ici, c’est notre vie et le geste, c’est ce petit moment pris chaque jour.
Un temps particulier. Nous sommes des êtres incarnés et nous appartenons à l’espace et au temps, tout ce que nous faisons s’inscrit dans le temps. Pour vraiment lire la parole fructueusement il est donc nécessaire de lui réserver un temps particulier dans notre journée. Un temps particulier propice, autant que possible, au silence et au calme. Souvent le matin tôt avant une 4Prendre un temps de lectio chaque jour, c’est semer dans notre cœur la semance de Dieu dans notre vie...4 journée de travail ou le soir. Il est important de se souvenir que « ce qu’’on ne fait pas chaque jour, on ne le fait pas durant toute sa vie ». Ce qui importe c’est la fidélité et pas forcément la quantité. Le risque, c’est de ne pas définir ce temps, c’est que notre lecture prenne simplement la place vide dans notre emploi du temps, une place qui témoignerait de notre peu d’amour pour la parole du Seigneur ! Par une lecture régulière et fidèle nous plantons alors dans notre vie cette semence de la Parole, comme un semeur qui répète son geste à chaque pas pour ensemencer tout un champ. Or notre champ, ici, c’est notre vie et le geste, c’est ce petit moment pris chaque jour.
![]() Des passages déterminés, afin d’éviter à tout prix de sélectionner, de déformer, la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle il nous faut écouter et non pas prendre ce qui nous est le plus facile, ou ce qui cadre le mieux avec notre état d’esprit du moment. Dans la lecture de la parole de Dieu, celui qui a l’initiative de la rencontre c’est Dieu, qui vient à nous. 4S’obliger à une lecture suivie c’est décider de ne pas choisir, mais laisser Dieu nous parler à sa guise ! 4Utiliser le lectionnaire de la lirugie est toujours un bon choix puisqu’il nous met en communion avec les lectures de la liturgie que nous célébrons chaque fois que nous y allons. On peut aussi lire un livre à la suite, l’intérêt alors est de saisir le texte dans sa continuité. Mais au fond l’important est que chaque jour nous n’ayons pas à choisir le texte que nous allons méditer, qu’il nous soit donné par un rythme que nous avons choisis au début. Afin que nous puissions dire chaque jour : « parle Seigneur ton serviteur écoute » [5] .
Des passages déterminés, afin d’éviter à tout prix de sélectionner, de déformer, la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle il nous faut écouter et non pas prendre ce qui nous est le plus facile, ou ce qui cadre le mieux avec notre état d’esprit du moment. Dans la lecture de la parole de Dieu, celui qui a l’initiative de la rencontre c’est Dieu, qui vient à nous. 4S’obliger à une lecture suivie c’est décider de ne pas choisir, mais laisser Dieu nous parler à sa guise ! 4Utiliser le lectionnaire de la lirugie est toujours un bon choix puisqu’il nous met en communion avec les lectures de la liturgie que nous célébrons chaque fois que nous y allons. On peut aussi lire un livre à la suite, l’intérêt alors est de saisir le texte dans sa continuité. Mais au fond l’important est que chaque jour nous n’ayons pas à choisir le texte que nous allons méditer, qu’il nous soit donné par un rythme que nous avons choisis au début. Afin que nous puissions dire chaque jour : « parle Seigneur ton serviteur écoute » [5] .
![]() Une grande fidélité. Comme pour la prière, la lectio divina ne portera son fruit que si on le fait fidèlement, assidûment. Non pas à cause du commandement, mais parce que c’est la logique même de la vie spirituelle ; en priant on parle à Dieu, ô combien c’est important, mais en lisant c’est Dieu qui nous parle.4La fidélité veut simplement dire qu’ on a besoin d’écouter Dieu comme on a besoin de respirer ! 4 Or la vraie vie spirituelle est un dialogue d’amour entre Dieu et nous. En effet tout progrès spirituel vient de la lecture de la Parole, c’est en elle que nous pouvons trouver ce face à face avec Dieu. Lire sans prier, déssèche le cœur, mais prier sans lire enferme l’âme dans ses propres pensées.
Une grande fidélité. Comme pour la prière, la lectio divina ne portera son fruit que si on le fait fidèlement, assidûment. Non pas à cause du commandement, mais parce que c’est la logique même de la vie spirituelle ; en priant on parle à Dieu, ô combien c’est important, mais en lisant c’est Dieu qui nous parle.4La fidélité veut simplement dire qu’ on a besoin d’écouter Dieu comme on a besoin de respirer ! 4 Or la vraie vie spirituelle est un dialogue d’amour entre Dieu et nous. En effet tout progrès spirituel vient de la lecture de la Parole, c’est en elle que nous pouvons trouver ce face à face avec Dieu. Lire sans prier, déssèche le cœur, mais prier sans lire enferme l’âme dans ses propres pensées.
![]() Lire enfin avec un cœur pur ! Lire le texte pour lui-même et le contempler, puis s’arrêter aussitôt après ; sans encore engager d’autres facultés que l’attention... lorsque quelqu’un lit, dit un moine du Moyen-Age, le Père lui parle ou bien lui-même parle au Père , le Fils lui parle ou bien lui-même parle au Fils, le Saint-Esprit lui parle ou bien lui même parle au Saint- Esprit". Il s’agit d’écouter et d’accueillir avant même de réfléchir c’est à dire écouter la parole de Dieu de manière vitale. La lecture est à faire avec tout l’être, avec le corps-car normalement on prononce les paroles avec les lèvres- avec la mémoire qui les fixe, avec l’intelligence qui en comprend le sens.Le fuit d’une telle lecture, c’est l’expérience d’une familiarité avec Dieu.
Lire enfin avec un cœur pur ! Lire le texte pour lui-même et le contempler, puis s’arrêter aussitôt après ; sans encore engager d’autres facultés que l’attention... lorsque quelqu’un lit, dit un moine du Moyen-Age, le Père lui parle ou bien lui-même parle au Père , le Fils lui parle ou bien lui-même parle au Fils, le Saint-Esprit lui parle ou bien lui même parle au Saint- Esprit". Il s’agit d’écouter et d’accueillir avant même de réfléchir c’est à dire écouter la parole de Dieu de manière vitale. La lecture est à faire avec tout l’être, avec le corps-car normalement on prononce les paroles avec les lèvres- avec la mémoire qui les fixe, avec l’intelligence qui en comprend le sens.Le fuit d’une telle lecture, c’est l’expérience d’une familiarité avec Dieu.
![]() Respecter le texte Premièrement, il convient de lire le texte comme il est afin de le prendre au sérieux dans la force et la pensée qui lui sont propres et ne pas chercher à appliquer le texte trop hâtivement à une situation concrète ou l’écouter en fonction de notre situation ou de nos idées. Qu’on évite tout subjectivisme : la Parole doit être reçue dans son objectivité et on doit essayer de comprendre ce que le texte signifie en lui-même.
Respecter le texte Premièrement, il convient de lire le texte comme il est afin de le prendre au sérieux dans la force et la pensée qui lui sont propres et ne pas chercher à appliquer le texte trop hâtivement à une situation concrète ou l’écouter en fonction de notre situation ou de nos idées. Qu’on évite tout subjectivisme : la Parole doit être reçue dans son objectivité et on doit essayer de comprendre ce que le texte signifie en lui-même.
![]() Adopter le regard de Dieu Il n’y a pas à rechercher l’efficacité, l’émotion sensible au niveau psychologique, cela pourrait nous faire tomber dans la technique, en nous ramenant au monde et à ses séductions. Il ne s’agit pas d’arriver à des résultats fixés d’avance sous peine de demeurer dans la recherche 4La parole de Dieu, quand elle habite en moi, devient parole de vie, elle me permet d’adopter le regard même de Dieu sur moi, sur les autres et sur le monde4 complaisante de soi-même. Ne nous laissons pas séduire : aucune introspection, mais un regard sur la vérité de notre être, comme du dehors, par un regard illuminé par Dieu. Le but de cette familiarité avec la parole de Dieu, c’est d’apprendre à voir les choses, les gens, les événements et bien entendu nous- mêmes comme Lui les voit. Par exemple, voir ma propre personne à travers le regard de Dieu, ce sera accepter de laisser entrer en moi certaines paroles comme « merveille que je suis, merveille que tes œuvre Seigneur », parole qui est, si je la laisse devenir vivante en moi un remède très puissant contre la déprime et qui ouvre ma vie à un optimisme enraciné en Dieu.
Adopter le regard de Dieu Il n’y a pas à rechercher l’efficacité, l’émotion sensible au niveau psychologique, cela pourrait nous faire tomber dans la technique, en nous ramenant au monde et à ses séductions. Il ne s’agit pas d’arriver à des résultats fixés d’avance sous peine de demeurer dans la recherche 4La parole de Dieu, quand elle habite en moi, devient parole de vie, elle me permet d’adopter le regard même de Dieu sur moi, sur les autres et sur le monde4 complaisante de soi-même. Ne nous laissons pas séduire : aucune introspection, mais un regard sur la vérité de notre être, comme du dehors, par un regard illuminé par Dieu. Le but de cette familiarité avec la parole de Dieu, c’est d’apprendre à voir les choses, les gens, les événements et bien entendu nous- mêmes comme Lui les voit. Par exemple, voir ma propre personne à travers le regard de Dieu, ce sera accepter de laisser entrer en moi certaines paroles comme « merveille que je suis, merveille que tes œuvre Seigneur », parole qui est, si je la laisse devenir vivante en moi un remède très puissant contre la déprime et qui ouvre ma vie à un optimisme enraciné en Dieu.
![]() Dans le texte, la parole de Dieu est présente. Au fond, il faut entendre la voix, écouter la parole qui vient à nous toujours dans un aujourd’hui, dans l’instant présent. Cette parole, nous la trouvons bien sûr liée à un événement passé, à une histoire lointaine, mais étant force et puissance de Dieu elle recrée pour nous 4« si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples » Jean 8 31. 4un nouvel aujoud’hui chaque fois que nous l’écoutons.
Dans le texte, la parole de Dieu est présente. Au fond, il faut entendre la voix, écouter la parole qui vient à nous toujours dans un aujourd’hui, dans l’instant présent. Cette parole, nous la trouvons bien sûr liée à un événement passé, à une histoire lointaine, mais étant force et puissance de Dieu elle recrée pour nous 4« si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples » Jean 8 31. 4un nouvel aujoud’hui chaque fois que nous l’écoutons.
Alors, entendre la parole de Dieu, c’est réaliser qu’aujourd’hui Dieu me parle, que cette parole d’un temps lointain « contient » la parole vivante de Dieu qui est toujours vraie pour moi, toujours lumière.
[5] C’est très différent de dire, Seigneur dis-moi ceci ou cela aujourd’hui !
Vous trouverez dans la méditati,
Lire le texte, le questionner... Qu’est-ce qu’il veut dire dans son vocabulaire, son style littéraire, sa structure, son fond historique, les idées théolgiques qu’il met en œuvre et leur histoire ? Pour cela, il faut s’aider par les données de la science biblique, les dictionnaires, les commentaires, mais aussi ceux de la tradition des Pères, des saints... mais attention ! surtout il serait très dommageable d’en rester là... car le vrai but n’est pas d’accumuler des connaissances sur le texte, mais de le laisser parler, de le laisser me parler. C’est ce qu’on appelle méditer. La lecture spirituelle n’est pas une aventure archéologique, mais elle veut laisser Dieu prendre la parole.
Vous trouverez dans la méditation.
Le type de connaissance que l’on recherche n’est pas l’érudition (même si l’érudition des savants nous est très précieuse) mais c’est une intelligence intégrale de la Bible. Intégrale ici veut dire non seulement de toute la Bible mais surtout demande un regard unifiant des textes bibliques. Cette unification n’est pas littéraire [6], elle n’est peut être pas théologique [7], elle est spirituelle, elle est présente dans un acte de foi. C’est en lisant dans la foi que la Bible devient la « lettre d’amour » que Dieu écrit à l’humanité et donc m’adresse à moi.4Le but de la lecture spirituelle, c’est de donner par notre étude l’occasion à Dieu de prendre la parole4 Il est clair que pour lire la Bible comme cela, l’érudition est utile mais elle n’est pas forcément nécessaire. Il suffit de lire le texte dans la foi, dans cet abandon, d’accepter d’être placé devant le mystère pour que la Parole, même si nous la comprenons plus ou moins bien, nous parle de notre Dieu. Ceci est très important car tout le monde peut faire cette lecture, elle n’est pas réservée à ceux qui ont le temps d’étudier.
Cete méthode veut qu’on lise la Bible par la Bible, elle procède par rapprochements, parallèles, comparaisons. Les textes s’éclairent les uns les autres. Pour cela une bonne Bible, avec les notes et les passages similaires en marge est un très bon instrument. Ce que l’on veut alors saisir, faire monter à notre conscience, c’est la façon d’agir de Dieu, sa pédagogie envers nous.
Se souvenir de la Parole.
Pendant la lecture, il fallait de l’attention, maintenant c’est la mémoire qui doit travailler, afin que la Parole reste dans ma pensée. Comme on fait durant la journée de petites pensées vers Dieu, on peut, avec un peu d’habitude, se remémorer les quelques paroles que nous avons récolté pendant la lecture, pour les faire exister en nous, pour reprendre ce vis-à-vis avec la présence du Verbe en notre cœur.
Le fait de mémoriser la parole de Dieu est un fait constant dans la tradition de l’Eglise ancienne, il suffit pour s’en convaincre de lire les écrits qui sont émaillés de citations, d’allusions. C’est une mémorisation qui n’est pas mécanique, mais qui fait que la Bible devient le fond culturel d’où nous tirons nos références, qui stimule notre penséeet qui fait que petit à petit nous entrons en connivence avec l’Auteur ultime que nous désigne notre foi, Dieu Lui- même.
[6] En effet il y a trop d’auteurs, de styles et la Bible est écrite sur une période de temps de 300 ans ; l’unité littéraire n’est pas possible
[7] Car on peut trouver plusieurs théologies, plusieurs façons de voir Dieu, entre par exemple le Dieu de la bénédiction qui appelle Abraham et celui de la sagesse ! L’unité n’est pas théologique
La méditation ici est l’attitude mariale par exellence, elle qui méditait toute chose dans son cœur, elle qui laissait exister dans son cœur tous les événements incompréhensibles, ces paroles qui ne voulaient pas prendre sens, sans les oublier jusqu’à ce qu’elles prennent sens sous l’action de l’Esprit de Dieu. Comment a-t-elle compris en un premier temps la parole « un glaive te transpercera le cœur » ? Il a fallu probablement beaucoup de méditation pour en arriver là.
Méditer enfin
Méditer, c’est aussi mettre en pratique, car la parole de Dieu révèle sa puissance à partir du moment où on la met en pratique. On peut lire l’évangile de la providence « les oiseaux du ciel ne sèment ni ne filent... », si on n’a pas vécu le fait que Dieu prend soin de nous, eh bien on trouve le passage joli et l’on n’y voit pas grand chose à méditer. Qu’on fasse l’expérience concrète de la sollicitude de Dieu pour nous et cela change bien ! Une parole vécue apportera beaucoup plus de lumière intérieure qu’une simple idée, même belle.
Cette méditaion est très personnelle puisqu’elle est en quelque sorte notre réponse, la réponse qui naît de notre cœur, du contact avec la parole de Dieu. Cette méditation, c’est une réponse vitale, un vis-à-vis avec le Verbe de Dieu, qui nous parle par le texte. Parfois cette réponse devient larmes de joie joie La joie est une émotion très importante. Elle est faite d’une composante physique (exitation, rire, sourire, détente intérieures,...) psychologique (ouverture, pensées positives, désir...) mais aussi, et c’est là qu’elle se distingue du plaisir ou de la motivation, spirituel. Elle a donc une composante psycho-physique mais s’enracine aussi dans le monde des valeurs, ces choses importantes par dessus tout et qui nous font participer à ce qui est plus grand que nous. , ivresse ; il convient alors de l’accueillir, parfois cette joie joie La joie est une émotion très importante. Elle est faite d’une composante physique (exitation, rire, sourire, détente intérieures,...) psychologique (ouverture, pensées positives, désir...) mais aussi, et c’est là qu’elle se distingue du plaisir ou de la motivation, spirituel. Elle a donc une composante psycho-physique mais s’enracine aussi dans le monde des valeurs, ces choses importantes par dessus tout et qui nous font participer à ce qui est plus grand que nous. est plus ténue mais c’est toujours ce flot profond qui vient de notre cœur qui 4La méditation est notre réponse à la parole de Dieu, parfois une joie joie La joie est une émotion très importante. Elle est faite d’une composante physique (exitation, rire, sourire, détente intérieures,...) psychologique (ouverture, pensées positives, désir...) mais aussi, et c’est là qu’elle se distingue du plaisir ou de la motivation, spirituel. Elle a donc une composante psycho-physique mais s’enracine aussi dans le monde des valeurs, ces choses importantes par dessus tout et qui nous font participer à ce qui est plus grand que nous. , une lumière se manifeste dans notre cœur et nous pressentons cette présence de l’Esprit de Dieu qui s’empare de notre être...4s’écoule. Quand la parole a ainsi éveillé notre cœur, nous pouvons nous rendre compte qu’elle habite en nous d’une façon nouvelle. Souvent encore il nous faut rester fidèles dans notre travail de lecture et de méditation, il nous faut marcher avec le Christ sur le chemin des Ecritures même s’il est sec et rocailleux... mais laisser au Seigneur l’initiative de nous rejoindre comme par surprise.
Quand la lecture, la méditation, sont difficiles, il faut bien comprendre que par nos efforts nous frappons à la porte (« frappez et l’on vous ouvrira »).C’est donc bien ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes aussi comme celui qui travaillerait la terre pour que 4Par la parole c’est Dieu Lui-même qui frappe à notre cœur, le laisserons-nous entrer ?4la semence ne tombe pas sur le sol pierreux, ni dans les épines ! Mais plus profondément encore, quand nous peinons, c’est le Christ Lui-même qui frappe à la porte de notre cœur par le texte que nous lisons. Le texte, ne l’oublions pas, est parole du Seigneur, c’est sa façon à lui de frapper à la porte de notre cœur.
La contemplation
Toute page d’Ecriture nous dévoile le Christ et nous le fait apparaître dans la lecture. Il s’annonce en suscitant un étonnement émerveillé. Admiration, surprise, étonnement émerveillé, la contemplation est avant tout cela. Le regard de Dieu qui s’est manifesté sur nous dans la lectio divina devient maintenant en nous notre regard le plus profond, il nous permet en regardant la réalité et les autres d’y découvrir la présence de Dieu qui est partout. La contemplation n’est ni extase ni expérience extraordinaire mais c’est l’ordinaire : regarder celui qui est le plus beau des enfants des hommes, celui qui est bon et qui fait du bien. 4Tout doucement, la méditation est devenue un simple regard sur celui dont la présence est manifeste pour notre cœur. 4 Tout doucement la méditation est devenue un simple regard sur celui dont la présence est manifeste pour notre cœur. Il ne s’agit plus de faire des pensées sur Dieu mais bien d’entrer dans l’oraison, c’est à dire de goûter, pas toujours avec nos sens mais bien avec la certitude de notre foi, à la présence de Dieu.
La lectio divina, n’est pas seulement une école de prière, elle est aussi une école de vie... En elle, Dieu nous appelle, nous parle, il suscite en nous la réponse docile, mais c’est pour nous envoyer, pour faire de nous des mandatés, des missionnaires dans le monde.
[1] terme latin qui désigne une lecture spirituelle de l’écriture.
[2] C’est à dire naissance avec.
[3] Temple de l’Esprit est une des images données par le concile Vatican II pour parler de l’Eglise. LG6
[4] Epiclèse veut dire appel de l’Esprit, c’est le moment où le prêtre dans la prière eucharistique appelle l’Esprit saint sur les dons pour qu’il deviennent le corps et le sang du Seigneur.
[5] C’est très différent de dire, Seigneur dis-moi ceci ou cela aujourd’hui !
[6] En effet il y a trop d’auteurs, de styles et la Bible est écrite sur une période de temps de 300 ans ; l’unité littéraire n’est pas possible
[7] Car on peut trouver plusieurs théologies, plusieurs façons de voir Dieu, entre par exemple le Dieu de la bénédiction qui appelle Abraham et celui de la sagesse ! L’unité n’est pas théologique

Le contact avec la parole de Dieu est décisif pour le croyant. Il doit devenir un contact vivant avec une personne et éviter à tout prix de chosifier le texte de l’Ecriture.
Une parole pour tous
C’est pourquoi il est absolument important pour un chrétien qui veut chercher Dieu de se poser la question : quelle place a la parole de Dieu dans ma vie ? Les Eglises réformées peuvent nous faire honte à nous catholiques parce que nous connaissons peu la parole de Dieu. Bien sûr nous avons le saint sacrement, mais attention, il perd sa capacité de transformer notre vie si nous ne l’entourons pas d’une connaissance de QUI il est. Or cette connaissance, c’est la parole qui peut nous la donner.
Un contact avec Dieu
La lectio divina que nous proposons ici sera une tentative de chercher et de nourrir un certain contact avec Dieu à travers sa parole. Ce contact n’est pas forcément une émotion, c’est une forme de connaissance par la foi. Il ne s’agit donc pas en premier lieu de fournir des sessions bibliques ou des masses de connaissances éxégétiques mais bien de chercher à mettre en rapport "ce que Dieu dit" dans un texte et ce qu’il "me dit aujourd’hui". Le but de la lectio divina, c’est donc de rechercher une unité entre ce que je confesse, ce que je dis de ma foi et ce que j’en vis.
Qui provoque un changement
Non pas comme une sorte de morale, qu’il faudrait appliquer, même si c’est aussi important, mais bien plus qu’une morale. Le changement que veut opérer en nous ce "contact" très particulier est un changement de regard. Un changement cognitif dirait-on aujourd’hui. Il ne s’agit pas dans cette lecture non plus de faire une sorte de yoga chrétien, de méditation, ni d’intériorisation(ce qui peut être très utile par ailleurs). Il s’agit d’apprendre à cerner de plus près chaque jour "la façon par laquelle Dieu, le Père le Fils et l’Esprit Saint voient qui est Dieu, qu’est le monde et qui je suis". Au fond il s’agit non pas d’une intériorisation mais d’une sorte de décentrage de soi pour chercher à entrer dans les pensées de Dieu telles qu’il nous les fait comprendre en nous parlant. Il s’agit donc d’un renouvellement de l’intelligence, d’une transformation personnelle dans notre relation à Dieu, aux autres, au monde et bien sûr à nous-mêmes.
Bonnes questions :
![]() Mais comment entrer dans ce "contact" sans s’égarer dans les moralismes, psychologismes ou exégétismes qui ne sont pas de la "lectio divina" ?
Mais comment entrer dans ce "contact" sans s’égarer dans les moralismes, psychologismes ou exégétismes qui ne sont pas de la "lectio divina" ?
![]() Tout d’abord l’un n’empêche pas l’autre ; il est évident que le contenu moral de la Bible est à vivre, ce n’est pas une option ! Mais aussi tout savoir exégétique est important afin de vraiment comprendre ce que l’on lit ! Et l’adoration et la prière affective sont un grand moyen de communion avec Dieu.
Tout d’abord l’un n’empêche pas l’autre ; il est évident que le contenu moral de la Bible est à vivre, ce n’est pas une option ! Mais aussi tout savoir exégétique est important afin de vraiment comprendre ce que l’on lit ! Et l’adoration et la prière affective sont un grand moyen de communion avec Dieu.
![]() La première question que l’on peut se poser, donc, pour entrer en lectio divina c’est : "qu’est ce que Dieu dit dans ce texte ? Quelle pédagogie emploie-t-il avec l’humanité de tel personnage, de tel peuple ? " Cette question est importante car elle nous fait réfléchir non pas seulement sur le sens du texte, sur ce qui est écrit, mais sur ce que veut dire celui qui parle et à cause de notre regard de foi, celui qui parle c’est Dieu lui-même. Ici l’étude sera importante pour bien dissocier "ce que Dieu dit" de "la forme que cela prend" ou la pédagogie qu’il est obligé d’employer pour se faire comprendre. C’est ici que l’exégèse vient à notre aide.
La première question que l’on peut se poser, donc, pour entrer en lectio divina c’est : "qu’est ce que Dieu dit dans ce texte ? Quelle pédagogie emploie-t-il avec l’humanité de tel personnage, de tel peuple ? " Cette question est importante car elle nous fait réfléchir non pas seulement sur le sens du texte, sur ce qui est écrit, mais sur ce que veut dire celui qui parle et à cause de notre regard de foi, celui qui parle c’est Dieu lui-même. Ici l’étude sera importante pour bien dissocier "ce que Dieu dit" de "la forme que cela prend" ou la pédagogie qu’il est obligé d’employer pour se faire comprendre. C’est ici que l’exégèse vient à notre aide.
![]() Ensuite il convient, avec le temps, de se faire un regard panoramique sur la pédagogie de Dieu ; on peut être choqué par exemple que Dieu dans l’exode demande le sacrifice ! Mais si l’on voit où et comment il conduit son peuple vers une attitude toujours plus spirituelle jusqu’à lui apprendre le sacrifice des lèvres (la louange) et jusqu’à venir Lui-même être le sacrifice, on est plus à même alors de poser sur certains textes difficiles un autre regard.
Ensuite il convient, avec le temps, de se faire un regard panoramique sur la pédagogie de Dieu ; on peut être choqué par exemple que Dieu dans l’exode demande le sacrifice ! Mais si l’on voit où et comment il conduit son peuple vers une attitude toujours plus spirituelle jusqu’à lui apprendre le sacrifice des lèvres (la louange) et jusqu’à venir Lui-même être le sacrifice, on est plus à même alors de poser sur certains textes difficiles un autre regard.
Dans ma vie
Mais cette contemplation ne serait pas suffisante si elle n’entrait pas en dialogue avec la vie concrète de celui qui la recherche. D’une certaine façon, il ne faut pas chercher des résultats tangibles, des recettes ... chaque fois que nous sommes tentés de le faire c’est que nous sommes restés prisonniers de nous-mêmes et de nos propres pensées.
Le signe de ce "contact" si particulier, c’est justement que nous changeons sans effort, du moins sans forcément développer un grand volontarisme pour changer tel ou tel point. C’est un peu comme quand on comprend le sens d’une énigme, il y a un avant (on ne comprend pas, l’énoncé nous paraît obscur) et un après (ca y est... j’ai compris...). On ne peut pas produire cet éclair à la force du poignet, il faut que cela nous arrive. Ce contact est rarement aussi soudain que dans notre exemple mais quand on comprend quelque chose du coeur de Dieu et que c’est en rapport direct avec notre vie, cela produit inévitablement un changement.
La lectio divina est alors un moyen d’entrer en "contact" dans les réalités de la foi que nous professons, il s’agit d’une véritable ouverture, d’une aventure à la découverte de ce que Dieu veut nous dire de Lui-même.
Dans les articles qui suivront nous tâcherons d’ouvrir des pistes que chacun pourra emprunter ... pour suivre son chemin.
L’écoute de la parole de Dieu qui transforme le coeur.

Jésus fait pendant son ministère public des choses mémorables, il délivre oralement son message et dialogue avec d’autres (par exemple Jean Baptiste et des personnages religieux juifs). Jésus choisit des compagnons qui le suivent dans ses pérégrinations, ils voient et entendent ce qu’il dit et fait. Les souvenirs qu’ils conservent de ses paroles et de ses actions donnent ensuite le "matériel brut" sur Jésus. Jésus, Lui, n’a rien écrit, laissant le soin à ses disciples de la transmission de son message.
Les évangiles et la prédication de Jésus.
Dans cette première période de l’évangile, Jésus proclame la bonne nouvelle auprès des juifs, en galilée et à Jérusalem.
L’évangile est fait des souvenrirs des premiers disciples
Jésus fait pendant son ministère public des choses mémorables, il délivre oralement son message et dialogue avec d’autres (par exemple Jean Baptiste et des personnages religieux juifs). Jésus choisit des compagnons qui le suivent dans ses pérégrinations, ils voient et entendent ce qu’il dit et fait. Les souvenirs qu’ils conservent de ses paroles et de ses actions donnent ensuite le matériel brut sur Jésus. Jésus, Lui, n’a rien écrit, laissant le soin à ses disciples de la transmission de son message.
Les souvenirs des disciples sont déjà sélectifs puisqu’ils se concentrent sur ce qui appartient à la proclamation de Dieu par Jésus, et non aux détails de l’existence ordinaire (éléments du Jésus concret qui nous intéresseraient tellement aujourd’hui !).
A propos des actions et paroles d’un juif du début de notre ère !
D’un point de vue pratique, il est important pour le lecteur moderne de se rappeler qu’il s’agit de ce qui a été dit et fait par un juif vivant en Galilée et à Jérusalem durant les années 20 de notre ère. La façon de parler de Jésus , les problèmes qu’il affronte, son vocabulaire et sa perspective étant ceux de ce temps et de ce lieu là.
Beaucoup d’erreurs sur Jésus, sur l’interprétation de ce qu’il a enseigné viennent de cela. On imagine que Jésus répond à des problèmes qu’il n’a jamais rencontré. [1] Certaines images d’un Jésus héraut de la liberté, ou un Jésus prolétaire, paysan... sont aussi des erreurs. Jésus a été lui-même, un point c’est tout. Il est donc, si l’on veut comprendre l’évangile, très important de ne pas aller trop vite dans notre lecture. Il est capital de se poser la question du sens de telle parole en fonction de la culture ambiante à l’époque, mais aussi du sens que donne l’évangéliste quand il compose son texte pour arriver à déchiffer l’évangile. Par exemple un lecteur non averti pourrait s’étonner du fait que les pharisiens et les scribes soient tellement en discussion avec Jésus et, moyennant quelques remarques des évangélistes sur le fait que c’était "pour lui tendre un piège", pourrait penser qu’ils sont très malveillants. Or il faut savoir que ces discussion entre maîtres étaient fréquentes et ne signifiaient pas du tout une guerre ouverte mais bien une sorte de dialogue, comme au Moyen Age il y avait ce que l’on appelait une disputatio, sorte de dispute entre deux maîtres qui argumentaient l’un contre l’autre, dans leur recherche de la vérité. L’exemple de Luc 10, 29 qui nous vaut la parabole du bon samaritain en est un exemple. Si l’on avait pas la remarque de luc "pour l’éprouver" et "voulant montrer qu’il est juste" on ne pourrait pas déceler d’animosité entre les le scribe et Jésus. Il s’agit d’une discussion normale entre deux hommes de Dieu. [2] Ce serait ainsi mal comprendre Jéus que de le mettre en opposition totale avec les hommes de Dieu de son temps.
Après la Pentecôte, Jésus s’est manifesté comme vivant après sa mort, et Il envoie ses disciples dans la force de l’Esprit saint proclamer la bonne nouvelle. Ils découvrent qu’ils sont envoyés par Lui dans le monde entier...
De ce qu’ils ont compris de Jésus à partir de sa mort.
Ceux qui ont vécu avec Jésus, qui avaient vu et entendu comme témoins directs de la vie, de la mort et de la résurrection, ont été fortifiés par les apparitions du ressuscité. Ils ont reconnu en Jésus celui par qui Dieu a manifesté son amour sauveur pour Israel et finalement pour le monde entier. Une foi qu’ils expriment en donnant des titres à Jésus, titres que l’on retrouve dans les évangiles et qui expriment la foi de la première communauté chrétienne d’après Pâques. Ces titres christologiques sont une confession de foi : Il est Messie, Christ, Seigneur ,sauveur, Fils de Dieu...
Cette foi pascale illumine, donne sens à leurs souvenirs, ce qui fait que leur proclamation prend une signification plus profonde que simplement le souvenir d’un grand rabbi. On peut relire dans ce sens les récits de l’enfance pour voir que la visite des mages, par exemple, est mise en scène pour montrer que le Salut par Jésus doit atteindre toutes les nations et pas seulement le peuple juif.
Aux premiers prédicateurs, les apôtres, les douze (Juda est remplacé juste avant la Pentecôte) s’ajoutent ensuite d’autres envoyés (apôtre = envoyé), qui ajoutent une compréhension autre du Christ, selon leur culture.
Qu’ils ont raconté aux païens
Mais la prédication doit aussi s’adapter. Si Jésus était un juif galiléen, du premier tiers du premier siècle qui parlait araméen, au milieu du siècle son évangile est prêché dans la diaspora aux juifs et aux païens du milieu urbain et en grec... Il a fallu donc traduire, mais aussi adapter à des esprits et des situations très différentes l’évangile de Jésus de Nazareth. [3] Certaines traductions ont eu une influence très grande sur le devenir de la pensée et de la théologie de l’Eglise. Par exemple, le choix du mot "soma" pour parler du corps eucharistique de Jésus par les évangélistes synoptiques et Paul donne un sens plus abstrait qui permet aussi de parler du corps des chrétiens, comme d’un corps de métier. On aurait pu choisir le mot de Jean "sarx"( chair), beaucoup plus concret. Ce choix influence encore la théologie aujourd’hui !
A ce mouvement de prédication, qui est très important dans la formation des évangiles, il faut ajouter la liturgie, l’organisation des catéchèses, des communautés, les conflits qui ont pu marquer les débuts de l’Eglise. De tout cela on peut retrouver des traces dans l’Evangile. Par exemple, il est reconnu par tous les biblistes que le récit de l’institution eucharistique tel qu’il est dans nos évangiles est une sorte de formulaire liturgique introduit à cet endroit. Attention, ceci ne veut pas dire qu’il soit faux ! C’est simplement que la mise en forme de ce passage est arrivé jusqu’à l’évangéliste par la liturgie communautaire comme lieu de mémoire de Jésus.
Et qui fut rédigé 40 ans plus tard.
La mise par écrit des évangiles tels que nous les avons aujourd’hui à probablement été faite dans une plage de temps entre 60 et 100 ans arpès la naissance de Jésus. Certains documents existaient, qui étaient des recueils de paroles de Jésus, des catéchèses, des récits, tous perdus à ce jour. Les exégètes aujourd’hui ne pensent pas que les derniers rédacteurs des quatre évangiles canoniques aient été témoins oculaires. Ils ont travaillé à réunir des documents existants, venant eux des témoins oculaires, dans un récit ordonné [4] Au sujet de Mathieu et Jean, qui sont eux témoins oculaires, il est possible que l’évangile qui porte leur nom soit écrit selon une tradition qui remonte jusqu’à eux. Dire que les évangélistes n’ont pas été témoins oculaires permet de comprendre certaines diffcultés. Les évangélistes auraient travaillé sur des documents qu’ils auraient trié et synthétisés à leur facon, avec une visée pédagogique afin de transmettre la foi à une communauté particulière. En tout cas, il est clair que Les évangélistes sont de vrais auteurs, de vrais théologiens et non des journalistes de roman photo !Le plan des évangiles ne cherche pas à être chronologique, mais il est théologique et catéchétique. Cela explique certaines diversités. Comment par exemple la purification du temple par Jésus est-elle placée au chapitre 2 par St Jean, et 21 par Mathieu ? Un témoin oculaire saurait à quel moment cela eut lieu, alors que dans le cas contraire il a devant lui un événement qu’il doit intégrer dans son récit.
Les évangiles ont donc été aménagés dans un ordre logique et pas nécessairement chronologique. Les évangélistes sont des auteurs façonnant, développant, élaguant les matériaux reçus sur Jésus, et comme des théologiens, orientant ces matériaux d’une manière particulière. C’est pourquoi, en lisant tel texte, il sera intéressant de le comprendre à la lumière de ce que l’on sait de la théologie de son auteur, de ses soucis, de son but. C’est ce que nous tâcherons de faire dans les articles suivants.
Il est important enfin de comprendre que notre foi n’est pas dans l’écrit, mais dans la personne du Christ qui se rend présent au monde à travers le texte. Il n’est pas scandaleux d’apprendre que cela ne s’est pas forcément passé de cette façon, parce que nous savons (l’église s’engage là-dessus en proclamant le canon des Ecritures) que ce "visage de Jésus" présenté par nos quatre évangiles est fidèle.
[1] Progressistes (chrétiens de gauche en général) et conservateurs (de droite) font cette erreur. On peut se demander si Jésus servirait comme soldat dans une guerre moderne ou combien de sacrements il a organisés. La réponse exacte à de telles question est qu’un juif galiléen ne pouvait connaître l’existence de la guerre mécanisée et ne connaissait même pas le mot de sacrement !
[2] Voici qu’un légiste se leva, et lui dit pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?" 26 Il lui dit : "Dans la Loi, qu’y-a-t-il d’écrit ? Comment lis-tu ?" 27 Celui-ci répondit : "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même" — 28 "Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras." 29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : "Et qui est mon prochain ?" 30 Jésus reprit : "Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. 31 Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. 32 Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. 33 Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. 34 Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. 36 Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ?" 37 Il dit : "Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui." Et Jésus lui dit : "Va, et toi aussi, fais de même."
[3] Par exemple on voit la différence entre luc 5 19 où il est question de toit en tuile,typiquement gréco romain, contrairement à Mc 2,4 dont le toit palestinien permet d’y faire un trou !Luc 5,19 : " Et comme ils ne savaient par où l’introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au milieu, devant Jésus". Marc 2 : " Et comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l’endroit où il se trouvait et, ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique."
[4] Luc 1,1 : 1 Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 2 d’après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la Parole, 3 j’ai décidé, moi aussi, après m’être informé exactement de tout depuis les origines d’en écrire pour toi l’exposé suivi, excellent Théophile, 4 pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus.
